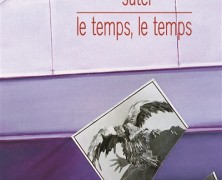Pour son 25ème long métrage, Steven Soderbergh nous présente Liberace, sorte d’hybride entre l’inoxydable Franck Michael et le mythique Zaza de la Cage aux folles. Liberace est une vedette extrêmement populaire du music-hall américain des années 60 et 70, homosexuel exubérant, bête de scène et roi incontestable du kitsch. Soderbergh se focalise sur la fin de carrière de la star, quand, vieillissante, elle vit une passion amoureuse avec Scott Thorson, éphèbe blondinet et musculeux, issu d’un milieu social nettement plus modeste. Le biopic est honnête sans être transcendant, drôle sans être hilarant, malin sans être brillant. Un assez bon divertissement tout au plus. La première apparition de Liberace expédie la question de son talent : il est immense. Seul sur scène, ses mains virtuoses courent sur le clavier de son piano. Il s’arrête en plein morceau pour haranguer la foule : alors que sa main gauche court toujours, il fait rire son public, lui explique certaines techniques de son boogie-woogie, joue avec lui. Face à ses admirateurs, Liberace est une bête, et, comme nous, Scott est bluffé par ce charisme et cette aisance. Et il y a le strass, les paillettes… De bout en bout, Ma vie avec Liberace adopte joyeusement le kitsch revendiqué par son héros. Âmes sensibles au mauvais goût, restez chez vous. Soderbergh choisit de concentrer les regards sur la relation problématique que vivent Scott et Liberace. Au début du film, le réalisateur prend soin de mettre en scène le prédécesseur du jeune homme et suggère ainsi que les amants sont interchangeables aux yeux de la vedette. Le personnel domestique du pianiste nous confirme rapidement que Scott n’est ni le premier, ni le dernier à s’ébattre dans les draps de soie de la villa pharaonique de Las Vegas. Dès lors, tout...
Une Dernière Fois la nuit, Sébastien Berlendis...
écrit par Marie-Anna Gauthier
Vaincu par l’asthme, un homme s’éteint progressivement, recroquevillé dans le lit naufragé d’une maison à l’abandon. C’est la fin d’un long chemin. Il arrive d’Italie après avoir retrouvé les lieux qui ont constitué sa mythologie personnelle : la maison natale de Bracca, petite tache parmi les pins sombres, dont l’atmosphère étouffante favorise l’épanouissement de la maladie ; San Pellerino, lieu de la première cure, des premiers soins pour modérer les crises, et de la naissance de l’amour ; la villa Luigia au bord du lac de Côme, dans laquelle l’amour est porté à son comble, jusqu’à l’agonie, puis la mort ; Trieste, le réconfort apporté par la mer et le soleil, la joie des autres corps…et enfin la maison du dix, chemin de la Résistance, sur le plateau d’Assy, cette dernière nuit. On devine que ces pérégrinations sont moins géographiques que mentales : l’homme se remémore, et le lecteur perçoit les traces de ces souvenirs au sein d’un jeu de reprises et de variations qui donne à l’ensemble l’allure d’un vaste poème en prose. La lecture est envoûtante, on se perd dans ce récit comme on se perdrait dans la contemplation d’un vieil album de famille. Dans sa forme discontinue, le récit se rapproche d’ailleurs de l’album : les blocs de texte sont les photos qu’on a délicatement collées sur l’espace blanc de la page. On les imagine en noir et blanc, parce que c’est ainsi que l’auteur souhaite nous raconter le parcours de cet homme dans cette Italie du Nord du début du siècle. Certains passages semblent envahis par un blanc solarisé, d’autres font la part belle au noir qui, dans sa dureté, crée d’émouvants effets de contraste. Ce jeu entre le noir et le blanc, tant sur la forme que sur le fond, exprime tout le paradoxe du...
Michael Kohlhass, Arnaud des Pallières
écrit par Marie Fernandez
Pour son dernier film, Arnaud des Pallières choisit d’adapter un roman d’Heinrich Von Kleist écrit en 1805. L’objet est singulier dans le paysage cinématographique et ne laisse certainement pas indifférent. La réduction extrême des dialogues, la ligne d’interprétation, toute en gravité et en retenue, la direction esthétique créent une étrangeté propre à plonger le spectateur dans l’ailleurs de la fable et parviennent à éclairer de façon souvent très juste les enjeux du récit. Demeure pourtant l’impression que le réalisateur, en voulant se tenir avec rigueur et obstination à ses choix, gaine son film et empêche le surgissement de l’émotion. Le cinéaste déplace l’intrigue de la province réformée de Brandebourg aux Cévennes françaises, terre d’asile des protestants dès le XVIème siècle, mais conserve la trame du récit. Le personnage central, Michael Kohlhass, qui a donné son nom au roman et aujourd’hui au film, est un marchand de chevaux prospère. Il vit en paix dans une famille unie et dans le libre exercice de sa foi protestante, jusqu’au jour où un voyage à la foire tourne mal. Un petit baron de la province a établi un péage illégal ; pour continuer sa route, Kohlhass est contraint de laisser en gage deux magnifiques étalons. Mais à son retour, il retrouve ses bêtes harassées et son homme de confiance, César, livré en pâture aux chiens. Il porte plainte, l’affaire est étouffée. Face à ce déni de justice, le commerçant se lance dans une quête éperdue pour que soit reconnu son bon droit : il envoie sa femme plaider auprès de la princesse, lève une armée, met le pays à feu et à sang. Dans son désir de réparation, satisfait par l’intégrité retrouvée du corps (celui du cheval, qui de manière symbolique peut apparaître comme un prolongement ou un...
Le Temps, le temps, Martin Suter
écrit par Guillaume Moreau
En Suisse, au pays des horlogers et à la ponctualité proverbiale, nier l’existence du temps est un comble. C’est pourtant ce à quoi travaillent Peter Taler et le vieux Knupp dans le dernier roman de Martin Suter, Le Temps, le temps. Le titre résume bien la quête obsessionnelle des deux protagonistes pour abolir le passage des ans. Peter Taler a perdu sa femme, assassinée un an plus tôt et depuis, le temps s’est arrêté pour lui : il reproduit inlassablement les derniers moments de la dernière soirée avant le meurtre de Laura. Quant à son voisin Knupp, son ambition, qui ne lui vaut au départ que mépris et ironie de la part de Taler, est de supprimer toutes les modifications qu’a subi son quartier depuis la mort de sa femme, de le restaurer dans son état d’origine et ainsi, d’abolir la disparition de Martha Knupp. Peter Taler va peu à peu s’investir dans l’impensable projet de son voisin en échange d’informations sur le meurtre de sa compagne. Deux questions sont donc supposées tenir en haleine le lecteur : qui a assassiné Laura Taler ? La folle entreprise de Knupp a-t-elle une chance d’aboutir ? Il faut rendre grâce aux premières pages du roman qui distillent une certaine étrangeté. Une sourde inquiétude émane de ce quartier sans histoire dans lequel on espionne ses voisins et où un drame s’est produit un an auparavant. Mais au fil de la lecture, le roman, à l’instar de cette banlieue suisse qu’il décrit, devient monotone, ennuyeux et perd le sel de ces pages initiales. Volontairement, Suter reste très en surface de ses personnages et ne fait guère dans la psychologie. Mais ce parti pris se retourne contre lui, car in fine, il reste bien peu d’éléments auquel le lecteur...