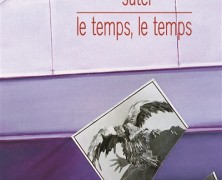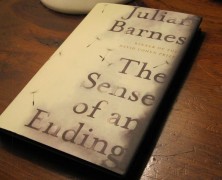Bien sûr, il y a ce roman dont personne, même six mois plus tard, n’aura oublié combien il a défrayé la chronique. Bien sûr, il y a la personnalité malicieusement provocatrice de Michel Houellebecq. Mais il y aura eu aussi, avant que l’auteur ne mette prématurément un terme à la campagne de promotion du livre, une série d’interviews dans les grands médias particulièrement intéressantes, captivantes même, où s’affrontent une lecture journalistique de Soumission au premier degré et le relativisme inébranlable de Houellebecq ; son art d’écrire en somme, que ce dernier roman illustre brillamment. Avant d’aller plus loin, résumons l’oeuvre : le narrateur, professeur d’université et spécialiste de Huysmans, mène une vie quelque peu monotone et triste, animée seulement de la présence de Myriam, une étudiante avec laquelle il entretient une relation instable. Autour de lui, le monde politique bouge. La France de 2017 a réélu François Hollande et en 2022, au moment où se déroule le récit, le pays est dans une phase de bouleversements : les habituelles formations de gouvernement sont malmenées par le Front National et par le parti musulman de Mohammed Ben Abbes, un très habile politique, doté d’une vision très forte pour la France. Ce dernier est finalement élu président et la République laïque prend fin. Ce qui provoque le trouble à la lecture de Soumission, ce n’est pas cette histoire en tant que telle. Non, c’est l’incroyable flottement du sens, rendu possible par le regard distancié, relativiste en diable du protagoniste. On peut s’agacer parfois des effets stylistiques d’un auteur devenu un as de l’écriture détachée, alliant un style soutenu à un trivial poisseux. Mais on ne peut être qu’admiratif du pouvoir de fascination qu’exerce un texte dont on ne sait d’où il parle. Tout passe par le regard franchement...
American Sniper, Clint Eastwood
écrit par Guillaume Moreau
Inspiré de l’autobiographie du tireur d’élite américain, Américan Sniper nous conte les allers-retours de Chris Kyle entre le champ de bataille irakien et son foyer familial. Le dernier Eastwood, réglé comme du papier à musique, est éminemment ambigu. Il en émane toutefois une tristesse sourde, à mettre au crédit de la très belle performance de Bradley Cooper. Dans le bourbier irakien de 2003, les Marines ont à leur côté des hommes comme Chris Kyle, des tireurs d’élite chargés d’assurer la protection de ceux qui risquent leur vie en première ligne. Chris Kyle, sniper chez les Seals, ne doute pas une seconde de sa mission ; dès l’enfance, son père lui a appris à se comporter comme un gardien des siens et de son peuple. Il a si bien retenu la leçon qu’il est devenu le sniper le plus meurtrier de l’histoire américaine. Chris Kyle est un homme hors norme, une légende pour les siens, « Shaytan », Satan, pour ses ennemis. Dans son impeccable interprétation du héros made in USA, Bradley Cooper a considérablement forci au point que, à côté de Kyle, tous semblent petits et fragiles. Le sniper est une bête, une montagne de muscles peu loquace et en même temps, le plus précis des tueurs. Le dernier film de Clint Eastwood raconte cette légende dans un découpage scénaristique on ne peut plus classique puisqu’après quelques scènes évoquant la jeunesse de Kyle, le film raconte alternativement ses missions en Irak et ses retours au Texas auprès de sa femme Taya et de leurs enfants. Et c’est à peu près tout. A l’image de son protagoniste, American Sniper est étonnamment peu disert et ne propose pas d’héroïque retournement de situation ; malgré le suspense qui sous-tend les scènes de guérillas urbaines, le film suit son cours comme...
Whiplash, D. Chazelle : Rythm is (not) love
écrit par Guillaume Moreau
Dans les interviews qu’il a données à la presse, Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash aime à rappeler qu’il a été, comme Andrew son protagoniste, un étudiant en batterie jazz. Est-ce suffisant pour écrire un bon film sur cette musique ? A l’évidence non, car malgré une maîtrise certaine de la mise en scène et de la tension dramatique, Chazelle réalise une œuvre assez pauvre dont le propos laisse pour le moins dubitatif… Andrew Neiman est un jeune homme qui sait ce qu’il veut. Admis à la prestigieuse école Shaffer, il n’a qu’un projet, simple et ambitieux, devenir l’un des tout meilleurs ; au point d’ailleurs de se délester des encombrants que constituent sa copine, sa famille… On n’ose pas dire ses amis, il n’en a pas. Prêt à tout pour réussir, il travaille des heures, seul, sur sa batterie, dans un box de répétition décoré de photos de ses idoles, dont Buddy Rich. Lorsque le réputé, le redouté Terence Fletcher l’admet dans son big band, il s’approche un peu plus de son rêve. Mais le maître est aussi un cruel pédagogue, usant des stratégies les plus retorses pour pousser ses élèves toujours plus loin. Dès leur seconde rencontre, il n’hésite pas à profiter des confidences que lui fait son nouveau poulain pour l’humilier en public. Très vite, leur relation musicale, qui constitue le cœur du film, tourne à l’affrontement. Damien Chazelle a confirmé dans la presse que Full Metal Jacket était une influence importante pour son film. Et en effet, on ne peut pas ne pas faire le lien avec la première partie de l’œuvre de Kubrick où l’aboyant sergent instructeur Hartman engueule et humilie les nouvelles recrues. Le problème avec Whiplash, c’est qu’il n’est fondé que sur ce procédé narratif. Les scènes de répétition...
Interstellar, Christopher Nolan
écrit par Guillaume Moreau
Dans une odyssée galactique incroyablement spectaculaire, Christopher Nolan a l’ambition démesurée de nous faire éprouver la relativité et de livrer les secrets enfouis au coeur de l’Univers. Malgré ses grosses ficelles, mission accomplie pour Interstellar… La terre se meurt des hommes qui l’ont trop exploitée. Elle se rebelle, oblige ses hôtes à vivre d’une agriculture limitée et les soumet aux tempêtes de sable qui ravagent les foyers et les poumons. Heureusement, la Nasa a un projet secret qui vise à envoyer notre espèce sur une planète habitable. Cooper, le chuchotant Matthew McConaughey, sera le pilote de cette mission ; il est le meilleur que la Nasa ait compté dans ses rangs, avant qu’il ne devienne, comme la plupart des hommes en âge de travailler la terre, un fermier doublé d’un père de famille. Mais Cooper appartient à la race des pionniers, des explorateurs, les yeux toujours rivés sur le ciel. Bref, c’est un Américain. Et il doit sauver le monde par un voyage interstellaire qui le mènera bien loin de chez lui et de ses enfants… Voyage durant lequel le spectateur découvre que l’amour transcende le temps et l’espace, qu’il fait de nous ce que nous sommes. Comme la singularité cachée au cœur du trou noir, l’amour est le secret humain que veut nous dévoiler Christopher Nolan. Bon. Il y a deux façons d’apprécier la dernière livraison de Christopher Nolan. On peut légitimement s’exaspérer des grosses ficelles avec lesquelles le film est construit : une morale de café du commerce (qu’il nous avait déjà peu ou prou infligée dans Inception), des contrastes sonores exubérants, un héros qui donne tout pour sa famille et son monde (un Américain donc), des séquences épiques, d’un pompier assumé. Sans compter une dernière demi-heure ésotérico-mystique qui a le malheur de vouloir...
l’Amour et les forêts, Eric Reinhardt
écrit par Guillaume Moreau
Bénédicte Ombredanne est une femme meurtrie, harcelée par un époux pervers et manipulateur. De ce qui ressemble à un tragique fait divers, Eric Reinhardt tire un beau roman, entaché toutefois de maladresses stylistiques et de choix narratifs peu convaincants… Tout sourit cette année à Eric Reinhardt, puisque son dernier roman figure déjà dans les listes de deux prix littéraires majeurs, le Renaudot et le Goncourt. L’Amour et les forêts est en outre largement plébiscité par la critique et les lecteurs : à l’heure où j’écris, le romancier est dans le top dix des meilleures ventes. L’auteur de Cendrillon n’est pas là par hasard et a patiemment construit son œuvre littéraire dès les années 90, avec pour fil rouge les rapports concrets de l’homme avec un capitalisme aliénant. Le Système Victoria, paru en 2011, constituait en quelque sorte le point d’orgue diablement efficace de ce travail. Avec L’Amour et les forêts, Eric Reinhardt déplace quelque peu sa perspective et aborde le harcèlement dont sont victimes les femmes au sein de leur vie conjugale. S’appuyant sur des témoignages reçus, il narre la vie tragique de Bénédicte Ombredanne, professeur de français discrète, victime d’un époux manipulateur et sadique qu’elle ne sait pas quitter. Dans cette existence violente, seule son aventure, fugace et bouleversante, avec un quasi inconnu rencontré sur Meetic, représente une consolation et lui permet de toucher du doigt le bonheur amoureux. Reinhardt possède à n’en pas douter le sens du romanesque. Il fabrique une mécanique redoutable dans laquelle le lecteur est inexorablement entraîné. Pour cela, certes, il faut passer les premières pages, peu inspirées et qui nous laissent à distance. Mais lorsque l’on entre enfin dans le foyer de Bénédicte Ombredanne, on est saisi par le sentiment du tragique devant ce personnage broyé par la présence...
Roman américain, Antoine Bello
écrit par Guillaume Moreau
Vlad Eisinger est journaliste au Wall Street Tribune et réalise une série d’articles autour d’un nouveau produit financier dont seule l’Amérique a le secret. Il étudie les rouages du life settlement, qui consiste à racheter les assurances-vie de particuliers en comptant sur leur décès prochain pour rafler la mise. Ce procédé est l’occasion de dérives moralement suspectes. Son terrain d’enquête est la petite ville de Destin Terrace, une bourgade de Floride où se croisent les professionnels de l’assurance, du life settlement et de simples retraités. Dan Siver, le deuxième narrateur de ce Roman Américain vit seul au sein de cette petite société, qu’il observe avec distance. Loin des combines financières, lui rêve d’écrire le prochain grand roman américain. Les personnages de Destin Terrace et la littérature sont d’ailleurs les deux sujets privilégiés des mails que s’échangent régulièrement Siver et Eisinger, bons amis depuis l’université. Le dernier roman d’Antoine Bello fait ainsi se succéder les articles de journaux, qui ouvrent chaque chapitre, les mails que s’envoient les deux compères et le récit de Dan Siver sur la vie à Destin Terrace. Son œuvre n’a volontairement rien d’un grand roman américain : on perçoit rapidement que l’enjeu pour Bello est de dépeindre, à travers le microcosme de Floride, l’individualisme et le manque d’aspirations d’une partie de la société américaine, tout affairée à courir après les dollars et à monétiser sa propre mort. La double narration, elle, permet de prendre la mesure de cette « american way of life », alternant la description macroéconomique du life settlement et l’observation de terrain que constitue le journal de Dan Siver. Mais en dépit de sa construction élaborée, a priori séduisante, le roman est une vraie déception. Roman Amércain souffre de deux défauts majeurs. Premièrement, son intérêt repose presque exclusivement sur les procédés...
Maps to the stars, David Cronenberg
écrit par Guillaume Moreau
Il existe chez David Cronenberg une fascination pour la monstruosité qui court à travers son œuvre. De La Mouche à son dernier Maps to the Stars en passant par Faux-semblants, le Canadien filme régulièrement des monstres en actes. Certes, tous n’ont pas l’hideux visage de Jeff Goldblum dans le film mythique de 1986, mais tous ont abandonné, au profit d’un rêve fou et (auto)destructeur, une part de leur humanité. Dans son nouveau long métrage, il n’y a presque personne à sauver. En tout cas pas la jeune Agatha dont on suit dès l’entame du film la venue à Hollywood. Une partie de son visage et de son corps est recouverte de brulûres dont on soupçonne vite qu’elles sont les stigmates d’un horrible secret. A la recherche d’un job, elle est engagée comme assistante (« slave » dit-on là-bas) par l’actrice Havana Segrand, brillamment interprété par Julianne Moore ; laquelle est presque défigurée tant elle s’efforce de conserver une apparente fraîcheur et une jeunesse qu’elle a définitivement perdues. Enfin, on ne sauvera pas la famille Weiss, et particulièrement le fils Benjie, jeune star infecte d’une franchise destinée au jeune public. Tous vont se croiser dans un ballet ridicule et épouvantable. Car chaque scène est un jeu de massacre. Une occasion de nous rappeler que derrière l’apparent glamour tout sourire, se cachent des animaux, prêts à tout, à emprunter les voies les plus tortueuses pour atteindre les étoiles. Ainsi, Stafford Weiss, interprété par l’excellent et répugnant John Cusak, joue les gourous du développement personnel, toujours prêt à débusquer chez ses clientes l’enfant qui sommeille en elles. En réalité, il est mû par une violence insondable, elle-même nourrie par un sordide secret de famille que le film nous révèlera. Là encore, le soin apporté à lui composer un visage à...
The Turn of Screw, Benjamin Britten
écrit par Guillaume Moreau
L’Opéra de Lyon a proposé en avril un festival autour des œuvres de Benjamin Britten. Parmi les trois opéras présentés au public, The Turn of Screw, inspiré de la nouvelle d’Henri James, retient l’attention par sa mise en scène ambitieuse et l’atmosphère résolument fantastique qui s’en dégage… Sans convaincre pour autant. Créée pour la première fois en 1954, cette œuvre assez courte condense de multiples références, le texte d’Henry James bien sûr, mais aussi des comptines d’enfants et la poésie de Yeats ; le tout dans un langage musical aux confins de l’atonalité et de l’harmonie classique. Cette concentration d’éléments concourt à l’élaboration de ce fantastique, au sens que lui donne Tzevan Todorov : une ambiguïté permanente, une hésitation, un trouble dans le réel. Bref, il y avait là pour la metteur en scène Valentina Carrasco un défi de taille à restituer et à soutenir l’équivocité de l’œuvre. Elle semble avoir opté pour une grille de lecture qui, bien qu’opérante, corsète terriblement le propos du compositeur britannique. Dans le prologue chanté par le ténor Andrew Tortise, on apprend qu’une gouvernante est engagée sur le domaine de Bly pour assurer l’éducation des jeunes Flora et Miles. Une fois sur place, elle se prend d’affection pour eux, mais perçoit un mal diffus à l’intérieur du manoir. Il semble que Flora et Miles soient hantés par les fantômes de Mrs Jessel, l’ancienne gouvernante et de Peter Quint, l’ancien valet, dont l’attitude avec les enfants aurait été pour le moins ambiguë. Le frère et la sœur font eux-mêmes preuve d’une attitude équivoque, entre une innocence propre à leur âge et une méchanceté souterraine. La gouvernante entreprend de sauver les enfants et de convaincre Mrs Grose, la bonne, de la réalité de ces visions spectrales. Avec un orchestre réduit, la musique...
Ida, Pawel Pawlikowski
écrit par Guillaume Moreau
Ida est la quête d’une identité à reconstruire. Dès les premières scènes, et avec un laconisme dont le film de Pawel Pawlikowski ne se départit jamais, on apprend qu’Anna s’appelle en réalité Ida et qu’elle n’est pas catholique, mais juive. Son noviciat touchant à sa fin, Ida est sommée par la supérieure du couvent de rencontrer sa tante, Wanda, laquelle lui raconte l’histoire de ses parents et les circonstances de leur mort. Ces derniers ont été trahis et assassinés par des paysans polonais qui s’étaient pourtant chargés de les cacher durant la Seconde Guerre mondiale. Commence alors pour les deux femmes l’enquête qui doit les amener à retrouver les corps de leurs proches et à leur donner une sépulture honorable dans un cimetière juif. Tout oppose Ida et Wanda. La première est taiseuse, discrète, élevée selon les préceptes rigoristes de la communauté religieuse où elle a grandi. Wanda est un pur produit du système soviétique, une juge haut placée, déterminée, séductrice et farouche avec les hommes, qu’elle prend et jette sans vergogne. Une chose cependant les unit, cette béance du passé, cette nécessité, une fois que celle-ci s’est fait jour, de clore le roman des origines, de ressusciter les morts pour mieux les enterrer. Une fois la quête achevée, il semble que chacune d’elles soit enfin en mesure de décider de sa vie et non de la subir. Pour raconter cette histoire douloureuse, Pawlikowski choisit le noir et blanc et une économie de mots qui, outre le fait qu’ils semblent répondre aux clichés que l’on attribue à la Pologne des années 60 (tristesse, grisaille, sévérité), font par moment basculer le film dans une austérité qui confine à l’ennui. Mais par ailleurs, le noir et blanc permet de très beaux tableaux, comme les plans ouvrant...
Operation Sweet Tooth, Ian McEwan
écrit par Guillaume Moreau
Dans une longue interview accordée à François Busnel pour le magazine Lire, Ian McEwan affirmait récemment : « La vraie force d’un roman réside dans sa capacité à représenter le paysage intérieur d’un personnage ». Dans le cas présent, celui de Serena Frome, héroïne et narratrice du dernier roman du Britannique. Contrairement à McEwan dans Operation Sweet Tooth, nous ne ferons pas durer le suspense : son dernier opus, sans être un pensum intolérable, n’a pas l’étoffe de ces grands romans où l’on quitte à regret les personnages et leurs « paysages intérieurs »… C’est au mieux divertissant, au pire vain. Pourtant, l’affaire s’annonçait plutôt bien : McEwan dépeint, au travers de la belle Serena, l’Angleterre des 70s’ tiraillée, comme la protagoniste d’ailleurs, entre un conservatisme de bon aloi et une soif de liberté mal dégrossie. La narratrice, jeune anglaise bien sous tout rapport, doucement rebelle et naturellement conformiste, rencontre Tony Canning, un ancien du MI5, les services de renseignement britannique. Celui-ci, à l’issue d’une période idyllique de formation amoureuse et intellectuelle, lui obtient un poste subalterne au sein de l’agence. Après quelques mois de travail de secrétariat, elle se voit confier une véritable mission, Sweet Tooth, dont l’objectif est de favoriser l’émergence et la diffusion d’auteurs favorables à l’idéologie du bloc de l’Ouest. Elle fait ainsi la rencontre de Tom Haley, un écrivain prometteur selon les critères du MI5, dont elle tombe éperdument amoureuse, au point de compromettre sa mission et sa carrière. Force est de reconnaître que le projet de MacEwan est ambitieux. Naviguant entre roman d’espionnage, roman d’amour et récit d’apprentissage, il brosse le portrait d’un Etat anglais morose, angoissé par son déclin, soucieux de contenir les assauts terroristes de l’IRA et l’invasion des idées marxistes, usant de la force mais aussi d’une forme de soft power qu’illustre l’opération Sweet...
Décompression, Juli Zeh
écrit par Guillaume Moreau
Lanzarote est une île paradisiaque, aride et sauvage, un soleil intense luit sur les facades blanches des demeures canariennes. Un lieu idéal pour Sven, ancien étudiant en droit reconverti en moniteur de plongée, dont le but, en s’y installant, était d’échapper à la société des hommes, à leurs jugements permanents. En quittant l’Allemagne, Sven a emmené avec lui Antje, sa compagne qui l’assiste à plein temps dans son entreprise de plongée touristique. Libéré des engagements du monde, baragouinant vaguement l’espagnol, Sven mène donc une vie retirée, tout entier absorbé par son activité sous-marine. L’arrivée de Theo et Jola, couple glamour et sensiblement perturbé, va bouleverser cet équilibre artificiel. Le dernier roman de Juli Zeh est un thriller psychologique dont la franche réussite tient d’abord à l’épaisse ambiguité du trio amoureux que forment Jola, Théo et Sven. Jola, la jeune et superbe actrice en attente du grand rôle de sa carrière, joue un double jeu dangereux. Elle aguiche outrageusement Sven mais guette en permanence les signes d’amour de Théo. Ce dernier, écrivain prometteur, est semble-t-il, en panne d’inspiration. Quant à ses pratiques sexuelles, elles témoignent d’une singulière perversité. Sven, si soucieux de rester à distance des conflits, est irrésistiblement attiré par la voluptueuse Jola ; sa volonté de désengagement est mise à rude épreuve au contact du couple. Sven est l’homme neuf, l’homme nouveau, à l’inverse de Théo, que Jola surnomme le « viel homme », tout à ses ruminations et à sa violence enfouie. Mais sa nonchalance, son calme de façade se fissurent insensiblement, à mesure qu’il s’empêtre un peu plus dans cette histoire confuse avec Jola, dont Théo est le témoin tour à tour complice et exaspéré. L’obscure tension du récit est habilement entretenue par la façon qu’a Juli Zeh de faire alterner les voix de...
Inside Llewyn Davis, Ethan & Joel Coen
écrit par Guillaume Moreau
How does it feel To be on your own With no direction home Like a complete unknown Like a rolling stone ?(*) Pour composer le personnage de Llewyn Davis, les frères Coen se seraient inspirés du guitariste-chanteur folk du début des années 60, Dave Van Ronk, dont le surnom, « the Mayor of MacDougal Street », dit bien l’influence qu’il avait dans le milieu musical du Greenwich village de l’époque. A l’inverse, Llewyn Davis n’est personne dans ce milieu, ou presque. Les réalisateurs choisissent symboliquement de le flanquer du chat de ses amis, échappé de leur domicile, et dont le nom est « Ulysse », lequel, dans le récit d’Homère, se fait aussi appeler « personne ». Et comme Ulysse, Davis va faire un long voyage. Llewyn Davis est un loser magnifique, un rambler sans le sou si souvent dépeint par les folkeux des 60’. Rien ne lui réussit et, dès les premières notes de la chanson inaugurale, il demande à mourir, à être pendu (Hang Me oh hang me), lui qui, bien qu’assez jeune, semble vieux de tous ses échecs accumulés. Dès le début de cet étrange objet cinématographique, Llewyn Davis est seul. Il chante seul, il se réveille seul dans un appartement qui n’est pas le sien. Il court après la reconnaissance artistique, il court après un lit, un canapé, un endroit où dormir quelques heures avant de retourner à sa vie de galère. Au milieu du film, il tente sa chance à Chicago auprès d’Albert Grossman, Le grand producteur folk de l’époque. Mais comme à peu près tout le monde dans sa vie, Grossman ne réagit guère à la grâce de sa musique : personne ne croit vraiment en lui. Mais lui-même, croit-il en qui que ce soit ? Inside Llewyn Davis : le film parle de lui, certes, mais...
Il faut beaucoup aimer les hommes, Marie Darrieussecq...
écrit par Guillaume Moreau
Marie Darrieussecq│Il Faut beaucoup aimer les hommes │ P.O.L │ 2013 Nous avions toutes les raisons du monde d’entrer à reculons dans le dernier roman de Marie Darrieussecq : la pente intellectualiste propre à P.O.L, le titre hommage à Marguerite Duras, patronage pour nous plus irritant que rassurant, la quatrième de couverture, à la limite du ridicule (« Une femme rencontre un homme. Coup de foudre. L’homme est noir, la femme est blanche. Et alors ? »)… Sans parler des vieilles accusations de plagiat qui ont émaillé par deux fois la biographie de cette docteur es Lettres, psychanalyste de surcroît. Néanmoins, la grande simplicité de cette histoire avait quelque chose d’attirant : Solange rencontre Kouhouesso à Hollywood, où elle exerce le métier d’actrice. Ils ont une histoire, puis se séparent. Le livre ne dépasse jamais les bornes de ce récit, vieux comme la littérature. Dès les premières pages, le roman met en avant la couleur de peau de l’amant. Kouhouesso est noir. Et de cela, Solange ne se remet jamais vraiment. Elle imagine, sous le grand corps d’ébène de l’homme qu’elle aime, l’exotisme de ses origines, une manière différente de penser le monde ; bref, une radicale étrangeté. Mais cette couleur de peau n’est que le symptôme d’une altérité bien plus grande. En effet, jamais Solange ne semble à même de saisir son amant, d’en comprendre les absences, les agacements, la distance puis les étreintes torrides. Tout le long du livre, la protagoniste attend son homme, espère qu’il va venir au bout de la nuit, patiente en voyageant, via Google Map, au cœur de l’Afrique, où elle pense dénicher son coeur. Elle est prête à le suivre au bout du monde, au bout surtout de son rêve à lui : filmer une nouvelle adaptation d’Au Cœur des ténèbres de...
Le Temps, le temps, Martin Suter
écrit par Guillaume Moreau
En Suisse, au pays des horlogers et à la ponctualité proverbiale, nier l’existence du temps est un comble. C’est pourtant ce à quoi travaillent Peter Taler et le vieux Knupp dans le dernier roman de Martin Suter, Le Temps, le temps. Le titre résume bien la quête obsessionnelle des deux protagonistes pour abolir le passage des ans. Peter Taler a perdu sa femme, assassinée un an plus tôt et depuis, le temps s’est arrêté pour lui : il reproduit inlassablement les derniers moments de la dernière soirée avant le meurtre de Laura. Quant à son voisin Knupp, son ambition, qui ne lui vaut au départ que mépris et ironie de la part de Taler, est de supprimer toutes les modifications qu’a subi son quartier depuis la mort de sa femme, de le restaurer dans son état d’origine et ainsi, d’abolir la disparition de Martha Knupp. Peter Taler va peu à peu s’investir dans l’impensable projet de son voisin en échange d’informations sur le meurtre de sa compagne. Deux questions sont donc supposées tenir en haleine le lecteur : qui a assassiné Laura Taler ? La folle entreprise de Knupp a-t-elle une chance d’aboutir ? Il faut rendre grâce aux premières pages du roman qui distillent une certaine étrangeté. Une sourde inquiétude émane de ce quartier sans histoire dans lequel on espionne ses voisins et où un drame s’est produit un an auparavant. Mais au fil de la lecture, le roman, à l’instar de cette banlieue suisse qu’il décrit, devient monotone, ennuyeux et perd le sel de ces pages initiales. Volontairement, Suter reste très en surface de ses personnages et ne fait guère dans la psychologie. Mais ce parti pris se retourne contre lui, car in fine, il reste bien peu d’éléments auquel le lecteur...
Une Fille, qui danse, Julian Barnes
écrit par Guillaume Moreau
Comment continuer à vivre lorsque les vérités sur lesquelles on a fondé son existence s’effritent soudainement ? Telle est la grande question posée par le nouveau roman de Julian Barnes. Six ans après Arthur et George, l’écrivain anglais revient avec Une Fille qui danse, récit plutôt habile d’une enquête, d’un travail de “corroboration” du passé qu’entreprend le protagoniste à l’occasion d’un étrange legs… Anthony Webster est le narrateur de ce roman constitué de deux parties distinctes. Dans la première, il raconte les “souvenirs approximatifs” d’une frange de son adolescence lycéenne durant laquelle il fait la connaissance d’Adrian Fynn, un jeune homme mystérieux, plus brillant que lui et ses deux amis proches, Colin et Alex. Il y raconte aussi sa rencontre avec Veronica Ford, son premier amour, vaguement calculatrice et hautaine, du moins dans son souvenir. Suite à leur séparation, elle se met en couple avec Adrian, qui se suicide quelques temps après. La véritable habileté du récit tient à sa seconde partie, qui est une relecture, quelques cinquante ans plus tard, de cette adolescence : le jeune Tony est devenu Anthony Webster, marié-divorcé, père et grand-père, un vieil homme qui mène une retraite paisible, vaquant à l’entretien de sa maison et à ses activités bénévoles. Il hérite par la mère de Veronica Ford du journal intime de son ancien ami Adrian. Aiguillonné par le possible contenu de ce document, il décide de le récupérer auprès de Veronica, qui refuse de le lui remettre. A cette occasion, il va revisiter son passé, découvrir combien le temps a altéré ses souvenirs et à quel point il s’est aveuglé sur son histoire personnelle. Roman sur le passage du temps, sur les failles et les illusions de la mémoire, Une Fille qui danse bénéficie d’une construction romanesque ambitieuse...
Syngué Sabour, Atiq Rahimi
écrit par Guillaume Moreau
Avec Singue Sabour, Atiq Rahimi se méprend lourdement : il ne veut pas faire du cinéma, mais « faire cinéma », comme quelqu’un qui voudrait « faire jeune » ou « faire moderne ». Entre les deux attitudes, il y a un gouffre, dont on mesure la profondeur à l’ennui qu’il suscite chez le spectateur.Tout est donc fait dans le plus strict respect des règles de l’art. La caméra se fige et saisit une lumière diaphane lors de scènes méditatives. Elle tremble lorsqu’il faut signaler l’angoisse, la peur, la violence. Les séquences se terminent par un beau tableau où lumière, personnages, objets sont scrupuleusement positionnés. Malgré cet effort, ou plutôt à cause de cet effort pour prouver qu’on fait du cinéma, l’adaptation est ratée. Et ce n’est pas la faute à cette histoire plutôt ingénieuse d’une femme afghane qui se libère par la parole. Incarnée par la très belle Golshifte Farahani, une épouse profite du coma dans lequel son mari – un héros de guerre – est plongé, pour lui raconter toute la vérité sur sa vie, ses mensonges, ses doutes, ses désirs les plus intimes comme elle n’avait jamais pu le faire de « son vivant ».Le film prend donc l’allure d’un long monologue entrecoupé de scènes de la vie sous les feux du conflit à Kaboul. Le problème réside dans le fait que Rahimi n’a pas l’intelligence cinématographique pour filmer ce dialogue en huis-clos avec un quasi-mort et le tout prend une allure didactique, que la réalisation maniérée et le jeu appuyé des acteurs viennent renforcer. Rahimi n’a pas réussi à produire des images qui auraient une force de suggestion par elles-mêmes, il a simplement mis en images son texte : nous, spectateur, sommes obligés de subir une récitation pénible agrémentée de quelques séquences de vie sans grand d’intérêt. Passez votre chemin ! Date de...
Django Unchained, Quentin Tarantino
écrit par Guillaume Moreau
Y avait-il encore quelque chose à attendre d’un film de Tarantino en 2013 ? Après Inglorious Basterds, parodie médiocre et longuette des films de guerre, après le diptyque Kill Bill, à l’imagerie léchée mais au propos sans intérêt, pouvait-on encore espérer de ce goinfre insatiable de séries B autre chose qu’une énième caricature et qu’un hommage décalé au western ? On se rend donc à reculons à ce Django Unchained et on en ressort avec le sentiment que Tarantino a enfin réalisé son premier film personnel, sans perdre pour autant sa capacité à jouer avec les codes des genres. Son habileté scénaristique, son art de filmer sont enfin au service d’un vrai propos, d’une vraie pensée sur le sujet central du film, l’esclavage. Django, noir asservi, est affranchi par King Schultz, un chasseur de primes humaniste, interprété par le toujours surprenant Christopher Waltz. A eux deux, ils entreprennent de racheter Brumhilda, la femme de Django, possédée par Calvin Candie (L. di Caprio). Pour ce faire, ils se font passer pour deux esclavagistes, Django tenant le rôle du bras droit, du conseiller. Avec Tarantino, on n’y coupe pas, on a droit comme à l’accoutumée aux scènes dialoguées tortueuses, aux combats sanguinolents, aux pastiches cinématographiques appuyés, à l’instar de ces zooms rapides sur un personnage, typiques des westerns spaghettis des 70s. Et, comme d’habitude, on prend plaisir à repérer les références, les citations cinématographiques que sème le réalisateur… A la différence près qu’ici cette mécanique bien huilée ne tourne pas à vide. Django, déchainé, ivre de vengeance, est un personnage vraiment héroïque, admirable dans son combat : on s’identifie, on l’aime, on le prend en pitié. Là où Tarantino fait fort, c’est que son protagoniste est animé d’une profonde ambiguité. Django ne lutte pas en premier lieu pour la...
Les Bêtes du sud sauvage, Benh Zeitlin
écrit par Guillaume Moreau
Dans le bayou où vivent Hushpuppy et son père, tout est poisseux, humide, sale et joyeusement délabré. Là, au milieu d’une petite communauté de marginaux, qui refusent le monde moderne, coupé du rapport direct à la nature, l’homme est comme l’animal : Hushpuppy joue, dort, mange avec les bêtes qui l’entourent et composent son jardin quotidien. Bientôt, la petite, en colère contre son père, le frappe en plein cœur et s’imagine que cette agression déclenche ce que l’on soupçonne être l’ouragan Katrina. Quoiqu’il en soit, la fillette, son père et quelques irréductibles de la communauté se réveillent au milieu des ruines de leur bidonville, submergé par les eaux… Ce grand changement est le point de départ de nouvelles aventures pour la petite : accompagner son père jusqu’à la mort, apprendre la survie, retrouver sa mère, mystérieusement disparue. Les Bêtes du Sud Sauvage a l’allure d’un conte initiatique. Benh Zeitlin s’empare de cette forme pour habilement estomper les limites entre le réel et l’imaginaire. C’est la grande force du film, de mêler un réalisme forcené avec les rêves et les peurs de la petite, figurées par de monstrueux et gigantesques aurochs, qui tout au long du film, se rapprochent dangereusement de la communauté. Mais la vie réelle est elle-même plus étrange encore lorsqu’on y a pour guide un père comme celui d’Hushpppy. Il maugréé, dévore, rit, danse, injurie, se bat contre la tempête à coups de fusil. Dwight Henry est fascinant dans ce rôle et charrie avec lui l’énergie et le dynamisme qui irradient en permanence le film. Zeitlin épouse cette vie perpétuellement mouvante avec sa caméra, toujours à l’épaule, instable et flottante à l’instar des eaux que parcourt la petite famille. Ce que l’on prend au départ pour un tic un peu vain de jeune réalisateur...
Le Sermon sur la chute de Rome, Jérôme Ferrari...
écrit par Guillaume Moreau
Marcel Antonetti naît au lendemain de la première guerre mondiale, benjamin d’une famille de six enfants. Devenu fonctionnaire et en partance pour l’Afrique de l’Ouest française, il juge convenable de se marier avant d’exercer ces nouvelles fonctions. Ce sera une jeune fille du village corse dont il est originaire qui lui donnera un fils, Jacques, et mourra en couche. Marcel, incapable d’élever seul ce fils, le confie à sa sœur, Jeanne-Marie, elle-même mère de Claudie. Les cousins germains, Claudie et Jacques, se marient, malgré la répugnance de leurs entourages et de leur union naissent deux enfants, Aurélie et Matthieu. Ce dernier, étudiant en philosophie à Paris, ne rêve que de revenir en Corse, qu’il imagine être son pays. Il profite de l’opportunité de reprendre le bar du village pour s’y installer avec son meilleur ami, Libéro. Après quelques mois où tout semble fonctionner pour le mieux, ce nouveau monde que Matthieu et Libéro ont fondé se détraque, s’abîme, jusqu’à la tragédie finale. Ce résumé, déjà fort long, ne rend pas compte de la densité d’un roman qui ramasse, en tout juste deux cents pages, un récit familial à travers lequel les mondes passent, s’effondrent, attendent de se lever. Cette densité est encore lestée par les références à l’époque de Saint Augustin, lui qui a témoigné de la chute de l’Empire Romain. La grande force du roman, sa puissance dramatique, tient précisément au fait que Ferrari fait peser sur ce microcosme, ce bar minable et héroïque, tout le poids de ces efforts humains passés pour (re)créer des mondes : l’histoire de Marcel, cousue en parallèle à celle de son petit-fils Matthieu, fait déjà état de cet effort, voué à l’échec, de s’inventer une existence, un destin, lorsque l’on vient après la Grande Guerre, après la grande...