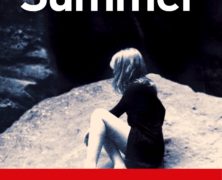Un jour d’été, sur les bords du lac Léman, Summer, jeune fille de dix-neuf ans, disparaît. Vingt-cinq ans plus tard, son frère Benjamin, rattrapé par le souvenir du passé enfoui, revient sur cet événement tragique. A la fois enquête policière et psychanalyse familiale – mais, depuis Oedipe, les deux ne sont-elles pas intimement mêlées? – Summer nous entraîne sous la surface lisse et glacée d’une famille apparemment idéale à qui tout semble réussir. Quoi de mieux que la Suisse, tranquille, aseptisée, comme décor à ce drame? Dès la première phrase, l’atmosphère inquiétante est mise en place : « Dans mes rêves, il y a toujours le lac. » Monica Sabolo nous plonge dans les profondeurs glauques des secrets de famille et distille progressivement les indices et les révélations comme autant de petits cailloux blancs qui mènent à la maison de l’Ogre. Tout à la fois efficace et poétique, Summer est un thriller réussi. Summer, Monica Sabolo, Le Livre de poche, janvier 2019, 289 pages. Quelle vie passionnante que celle de Gabriële Buffet, (en partie) retracée par ses deux arrière-petites-filles, Anne et Claire Berest! Musicienne qui se destinait à la composition, elle fut tour à tour épouse de Picabia, amie d’Apollinaire, maîtresse de Duchamp et de Stravinsky, résistante avec Beckett et mourut, oubliée de tous, à l’âge de cent quatre ans. A travers son destin hors norme, c’est une époque foisonnante qui est évoquée, ce début du XX° siècle où il semble qu’un nouveau mouvement artistique naisse tous les six mois : dadaïsme, orphisme, futurisme, cubisme… Elle fut de presque tous, à la fois muse et théoricienne. On regrette seulement que cette biographie qui mêle documents et fiction n’évite pas les maladresses et les clichés et que les auteures arrêtent brusquement ce récit de vie en...
Eugenia, Lionel Duroy
écrit par Marie-Odile Sauvajon
Lionel Duroy délaisse l’autobiographie qu’il poursuivait depuis son premier ouvrage Priez pour nous publié en 1990 et évoque indirectement ses obsessions à travers l’histoire d’Eugenia dans la Roumanie des années 1940. Il y est question de la montée du nazisme et de l’antisémitisme, de l’engagement de l’écrivain et, encore et toujours, du poids de la famille et de la complexité des relations dans la fratrie. L’histoire se déroule entre 1935 et 1945, à Bucarest et Jassy, deuxième ville de Roumanie. Eugenia, la jeune héroïne âgée de dix-huit ans au début du récit, est aussi la narratrice de ces dix années terribles sur lesquelles elle se penche. Etudiante à l’université de Jassy, sa vie bascule quand elle rencontre le grand écrivain roumain d’origine juive Mihail Sebastian, invité par sa professeure de littérature à l’occasion de son dernier livre, Deux mille ans. Pour la jeune fille naïve, issue d’une famille où les propos antisémites sont monnaie courante, c’est une découverte intellectuelle et le début d’une histoire d’amour. S’éloignant peu à peu de son milieu d’origine et surtout de son frère Stefan, militant d’extrême droite pro-hitlérien, elle devient journaliste, couvre le pogrom de 1940 dans sa ville natale puis pousse encore plus loin l’engagement en participant activement à la résistance contre l’armée allemande. A la fin de la guerre, parce qu’elle veut tenter de comprendre, elle écrit le récit de ces dix années. Dans ce roman historique, l’auteur mêle fiction et réalité: il invente le personnage d’Eugenia qu’il place aux côtés de figures historiques, parmi lesquelles Mihail Sebastian, auteur roumain au destin tragique[1]. Avec ces personnages et le choix de la Roumanie, Lionel Duroy opère un double décentrement, à la fois biographique et géographique. On découvre l’histoire méconnue de ce pays pris en étau entre l’Allemagne et...
Un paquebot dans les arbres, Valentine Goby
écrit par Marie-Anna Gauthier
Après l’encensé Kinderzimmer, Valentine Goby déconstruit le mythe des Trente Glorieuses à travers le destin de la famille Blanc, heurtée de plein fouet par la maladie. Un Paquebot dans les arbres est un très beau roman, porté par une héroïne solaire et un style remarquable. Ce paquebot blanc niché au cœur des arbres, c’est le sanatorium d’Aincourt, immense ensemble architectural construit en 1931, dont la majesté fait la fierté de toute la région. Mathilde, jeune fille à peine sortie de l’enfance, s’y rend chaque samedi pour voir ses parents atteints de tuberculose. Nous sommes au milieu des années 50, époque bénie des Trente Glorieuses, âge d’or de l’Après-Guerre, « temps miraculeux de la prospérité, de la Sécurité Sociale et des antibiotiques ». Le drame vécu par la famille Blanc semble anachronique, une histoire de maladie et de misère au temps du miracle économique. Avant la chute, les Blanc ont été les cafetiers de la Roche-Guyon, bourgade de la région parisienne. Le Balto est alors le centre névralgique du village, on y prépare la retraite aux flambeaux, on y sert les apéros de Pâques ou du 1er Mai, on y boit un verre à la sortie de l’église, on y trouve l’unique cabine téléphonique. Paul Blanc fait figure de patriarche bienveillant : il accueille les confidences, prête sans traites, oublie les dettes, ferme les yeux sur les vols : « Ma caille, c’est qu’ils en ont besoin ! » Le samedi, c’est soir de bal, tous les regards sont tournés vers lui, petit homme à l’harmonica qui fait danser les filles et les garçons. Mais la maladie passe par là, et avec elle, vient la dégringolade. Totalement imprévoyant, non éligible à la Sécurité Sociale réservée aux salariés, le couple bascule rapidement dans la spirale de la pauvreté : dettes, huissier, saisie, scellés, assistante...
Giboulées de soleil, Lenka Hornakova-Civade
écrit par Elodie Roca
Lenka Hornakova-Civade, originaire de Moravie, petite province de République Tchèque, signe un premier roman d’une beauté crue sur son pays d’origine, « dans la langue de [son] pays d’adoption ». Comme elle le précise dans sa postface : « Je ne pouvais exprimer qu’en français ce qui reste indicible dans ma langue maternelle ». Une très belle réussite couronnée par le prix Renaudot des lycéens 2016. Tout, dans ce roman, dit l’expatriation : c’est une histoire de femmes, dont les pères sont absents, une histoire de bâtardes héréditaires, qui se transmettent cette fatalité de génération en génération, pour former un clan matriarcal marginal et fort. Des femmes sans père et sans patrie, contraintes de se déraciner sans cesse pour fuir les hommes et l’Histoire, qui les pourchassent également. Il y a d’abord Marie, sage-femme autodidacte, belle et raffinée, qui s’est formée auprès d’un gynécologue juif de Vienne mais qui, pour survivre, arrache sa fille à la ville, s’entoure de silence et devient une rude paysanne de la campagne morave. On découvre peu à peu son histoire à travers le récit de Magdalena, sa fille, la première bâtarde. Elle-même devient mère hors du mariage et, alors que le pays bascule dans le communisme, elle donne naissance à Libuse. On perd alors la voix de Magdalena pour écouter le récit de sa fille qui grandit sous le communisme le plus strict. En 1968 pourtant, quelque chose a changé, l’air semble plus léger, c’est indéfinissable. Un vent léger a soufflé de Prague jusque dans le petit village. De ce printemps naît Eva, fille de Libuse, petite-fille de Magdalena, arrière-petite-fille de Marie. La dernière petite bâtarde prend en charge l’ultime récit : elle découvre, au contact d’une mystérieuse professeure de français, les parts les plus sombres de son histoire familiale et met un terme...
Juste la fin du monde, Xavier Dolan
écrit par Marie Fernandez
Xavier Dolan s’empare pour son dernier film d’un texte théâtral, Juste la fin du monde, écrit par Jean-Luc Lagarce en 1990. Il ne filme pas du théâtre mais propose une adaptation, une réécriture cinématographique de la pièce. L’intérêt du cinéaste pour ce dramaturge décédé du sida en 1995 ne surprend pas et pouvait sembler prometteur ; les deux auteurs partagent une même fascination pour les nœuds familiaux, mettant en jeu, œuvre après œuvre, les relations d’amour, de dépendance et d’enfermement au sein de la famille. Mais la rencontre ne tient pas ses promesses ; loin de permettre à Dolan de sublimer son jeune talent, elle l’accule au pire et métamorphose l’or en boue. Il faut dire que Mommy, le précédent long-métrage du réalisateur québécois, l’avait, à nos yeux, hissé à des sommets. Nous entendions bien les réserves de certains relatives au caractère très démonstratif de son écriture, à l’hystérisation des situations, à certaines facilités mais nous les contestions farouchement. Nous aimions et défendions la force de son cinéma, son impudeur, sa fougue. Mais après ce dernier film, on ne sait plus. Tout parait recette, cliché et surjeu. Premiers plans du film : Louis rentre voir sa famille après douze années d’absence pour annoncer sa mort prochaine. Avion, taxi. Tandis que la caméra suit la progression de la voiture sur la route, Dolan annonce la couleur en bande son : « home is not a harbour, home is where it hurts » chante Camille. Ce ne sera pas le seul tube lancé à force décibels et ce n’est pas la première fois que Dolan recourt à la musique pour relever l’intensité d’une situation. Il n’est pas question de faire systématiquement la moue lorsqu’un réalisateur utilise la dimension rythmique ou émotionnelle de la musique. Mais lorsqu’on appuie trop...
Captain Fantastic, Matt Ross
écrit par Sylvain Loscos
Véritable coup de cœur de la sélection Un Certain Regard, ce film magnifique sur l’amour d’un père pour ses enfants est interprété par un Viggo Mortensen impeccable et profondément humain. Non, Captain Fantastic n’est pas l’histoire d’un super héros prêt à sauver le monde. Et l’arrivée à l’improviste de Jean Luc Mélenchon dans la salle (qui viendra prendre place sur le siège voisin au nôtre), n’y changera rien. Ben (Viggo Mortensen) et Leslie ont fait un choix radical: élever leur six enfants loin des artifices de la société. Installée en forêt dans un cadre idyllique, la grande famille vie en parfaite harmonie avec son environnement. Au programme quotidien: chasse à l’arc et au couteau, exercices physiques, escalade, entretien du potager. Mais pas seulement : cours de culture générale, de littérature, de musique … Le cadre posé par la caméra est superbe. Les vies des personnages sont bercées de nature, de culture et d’entraide. On a envie d’en être. Mais ce parfait équilibre est bientôt rompu par le décès de Leslie qui, hospitalisée depuis plusieurs mois, met fin à ses jours. Ben et les enfants prennent la route pour se rendre à l’enterrement de leur mère bien aimée. La séquence de l’escale chez les cousins est la plus réussie. On sait que le choc des cultures est inévitable. Le contraste entre les deux familles est saisissant. Certains respirent le mépris, obsédés par leurs jeux vidéos et leur dernière paire de Nike, quand d’autres veulent dormir dehors pour profiter des étoiles. Mais le scénario en fait un peu trop sur l‘éducation parfaite de ces Robinsons new age et ne laisse entrevoir aucune faiblesse dans cette litanie. Les ados parlent trois langues (dont l’esperanto), les plus jeunes ont des connaissances avancées sur l’anatomie humaine. D’autres encore sont capables...
Mustang, Deniz Gamze Ergüven
écrit par Jessica Martin
Un village turc, aujourd’hui. Cinq jeunes sœurs sont confrontées au poids des traditions et contraintes d’abandonner liberté et légèreté pour devenir de bonnes épouses. Dans leur maison devenue prison, éprises d’une impérieuse envie de liberté, elles tentent d’échapper à leur sort. Deniz Gamze Ergüven signe ici un premier long métrage lumineux et terrible : elle filme avec grâce cinq jeunes filles sublimes, victimes d’une société « qui a tellement peur du sexe que tout devient sexuel »[1]. Un film poignant et engagé. Le film s’ouvre sur des larmes ; celles d’une fille de 12 ans qui fait ses adieux à son professeur. Mais ce chagrin d’école ne dure pas et laisse bientôt place à des jeux enfantins : les cinq sœurs s’amusent dans la mer avec des garçons. Scène légère, joyeuse, offrant aux spectateurs la beauté sauvage de ces filles dont la vie semble n’être inondée que de soleil et de promesses radieuses. Mais deux d’entre elles ont l’audace de grimper sur des épaules masculines, et l’allégresse tourne court. Dénoncées par une villageoise, les voilà donc accusées de se « masturber sur la nuque des garçons ». Face à l’absurdité de la situation, le spectateur jubile quand l’une des sœurs se met à brûler des chaises : « c’est dégueulasse, elles ont touché nos trous du cul ». On pressent d’emblée que le poids de principes ancestraux va happer ces filles aux airs d’héroïnes tragiques, et l’on songe volontiers au très beau Virgin Suicide de Sofia Coppola. Cependant, Coppola met en scène un tragique désincarné, quand celui de Deniz Gamze Ergüven est davantage sociétal puisqu’il nait du poids des conventions. Ces jolies filles ne sont pas bien nées, le film se déroule « à mille kilomètres d’Istanbul » au bord de la mer Noire. Leur sensualité apparaît comme un crime aux yeux de l’oncle et de la grand-mère...
Dans le Silence du vent, Louise Erdrich
écrit par Marie-Anna Gauthier
Joe a treize ans, trois amis pour la vie, une passion sans limite pour Star Trek et les seins de sa jeune tante. Il vit sur une réserve amérindienne du Dakota du Nord, entouré d’une famille unie : le père, juge aux affaires tribales, est l’incarnation d’une paternité confiante et solide ; la mère, généreuse et aimante, a le don de sacraliser le moindre événement du quotidien. Au-delà des frontières de ce cercle intime, il y a tous les autres : l’oncle pompiste, alcoolo notoire à la trempe facile ; la fameuse tante Sonja, plantureuse jeune femme, objet de tous les fantasmes adolescents ; les grands-parents, grabataires déglingués, dont la lubricité n’a d’égale que la joie de transmettre et de raconter ; et puis tous les autres, les cousins, les parents, les frères des amis, personnages hauts en couleur qui assument tous leur part de responsabilité (ou d’irresponsabilité…) dans la vie du jeune garçon. Toute cette smala vivote plutôt joyeusement dans les limites étroites de la réserve. Pas de misérabilisme de mauvais goût : ici, on n’est pas plus malheureux qu’ailleurs. Pourtant, le drame survient et renverse tout. Un soir, la mère de Joe est agressée : sauvagement battue et violée, elle doit à son seul sang-froid d’échapper à l’immolation. Enfermée dans le mutisme, elle tait le nom de son bourreau. Le père tente de répondre à cette violence par les armes qui sont les siennes : il participe aux maigres investigations, recueille des témoignages, revisite tous ses dossiers, formule des hypothèses. Mais toutes ses tentatives se heurtent à un hiatus juridique : si tout semble désigner le même homme, le procès ne peut s’ouvrir tant qu’on ne connaît pas l’endroit exact du crime. Or, l’agression s’est produite dans les environs de la Maison-Ronde, haut lieu de la réserve qui accueillait...
En finir avec Eddy Bellegueule, E. Louis
écrit par Marie Fernandez
Edouard Louis, 21 ans, normalien, jeune homme délicat et bien mis dont le discours bourgeonne déjà de références littéraires et philosophiques, n’est pas un héritier comme on pourrait l’imaginer. Non, lui déjoue sans demi-mesure les observations et analyses de Bourdieu, sociologue qu’il connaît bien pour avoir dirigé une étude sur son œuvre. Il n’est pas le brillant descendant d’une lignée d’universitaires parisiens mais l’indigne rejeton d’une misérable famille picarde. Edouard Louis n’est d’ailleurs pas Edouard Louis ; ce patronyme classique et bourgeois est celui qu’il s’offre pour sa naissance en littérature, dans une sorte d’auto-sacrement qui l’intègre à l’élite. Son nom d’origine, lui, marque sans doute possible le milieu populaire dont il est issu, si bien qu’on le croirait également inventé : Eddy Bellegueule est ainsi l’autre face d’Edouard Louis, à la fois réelle (comme identité administrative) et fictive (comme identité narrative de son premier roman). Edouard a comme on dit pris le large, coupé les ponts, largué les amarres. En finir avec Eddy Bellegueule est autant une façon de justifier cette prise de distance qu’une manière peut-être de trancher les derniers noeuds qui rattachent à cette identité passée. « De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux » : les premiers mots du roman annoncent la couleur. On pense à la célèbre phrase d’ouverture de Perec dans W ou le souvenir d’enfance, « Je n’ai pas de souvenir d’enfance ». Mais chez le jeune romancier, la mémoire de ce qui a été enduré est vive, précise, lancinante. Dans un récit méthodique divisé en chapitres thématiques ou chronologiques, Edouard Louis suit pas à pas le trajet de la souffrance. Il faut alors remonter aux origines car le drame d’Eddy Bellegueule est très tôt celui de l’inadaptation. Né dans un village ouvrier marqué par un ensemble de codes et...
Tel Père tel fils, Hirokazu Kore-Eda
écrit par Marie Fernandez
Tel Père tel fils, dernier long-métrage du réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda, a des allures de conte. La structure du récit est celle de bien des histoires de notre enfance : un personnage est confronté à une épreuve mais, au prix de transformations intérieures parfois douloureuses, en sort grandi. L’écriture cinématographique semble aussi imprégnée par certains des codes du genre : approche plutôt schématique des personnages, retenue du pathos, charge symbolique du plan. Même si l’on regrette parfois certains excès, le choix d’emprunter au genre du conte est très porteur pour réfléchir avec finesse aux pièges et bonheurs de la paternité. Deux familles découvrent que leurs fils de six ans ont été échangés à la naissance. L’hôpital qui les informe de la dramatique erreur les presse de procéder à l’échange. Les parents se trouvent ainsi jetés bon gré mal gré dans un long et douloureux processus : on commence par se rencontrer à l’extérieur, puis les garçons passent plusieurs week-ends dans leur famille d’ « adoption » avant d’y poser pour de bon leurs valises. Au fil de ces rendez-vous successifs, Hirokazu Kore-Eda dresse le portrait de deux familles que tout oppose. Chez les Nonomiya, installés à Tokyo dans un appartement ultra-moderne et sans vie (voir les nombreux plans sur l’appartement vide), le père rentre tard après son travail d’architecte. Tandis que sa femme soumise et tranquille lui sert le repas, il vérifie d’un oeil sévère que son fils unique a bien répété son piano. Chez les Saiki, petits commerçants dans une ville de province, la vie s’étire dans un joyeux désordre, au gré des jeux, des repas animés et des réparations de jouets cassés. Oui, spectateurs français, le dernier film d’Hirokazu Kore-Eda fait surgir vos souvenirs du grand succès populaire d’Emile Chatiliez, La Vie est un...
Suzanne, Katell Quillévéré
écrit par M.A. Gauthier et M. Devers
Suzanne a toujours fait ce qu’elle a voulu. Suzanne, à l’école, manque un repas parce qu’ « elle s’amuse bien avec les grands ». Suzanne, adolescente, garde le bébé parce qu’ « elle en a envie ». Suzanne, jeune adulte, abandonne l’enfant parce qu’elle aime. Itinéraire d’une enfant gâtée, pourrait-on dire, mais rien n’est moins sûr. Le personnage est suffisamment complexe pour éviter les jugements manichéens. La jeune fille est à la fois odieuse et sublime, misérable et grandiose. Suzanne a suffisamment de mystère et de force pour s’attacher le spectateur. Le voilà qui cherche à comprendre, à la dédouaner de ses fautes, à pardonner même s’il s’offusque. Le film de Katell Quillévéré raconte de manière linéaire la vie de Suzanne, jeune fille née dans un milieu populaire, de l’enfance à l’âge adulte. La mère est décédée ; le père, routier souvent absent, tente de combler tous ces vides. Il y parviendrait presque ; en témoignent les premières séquences du film qui se placent sous le signe de la gaieté et de l’allégresse. Le drame commence avec la rencontre de Julien, voyou rompu aux trafics en tout genre. Le cœur de Suzanne s’emballe, et voilà toute sa vie qui déraille : passion tumultueuse, dérapages violents, séjours en prison, cavale… Si la structure linéaire du film rappelle les récits de formation, la dynamique est ici enrayée : Suzanne n’apprend rien de ses errances, elle ne cesse de gâcher sa vie et celle de son entourage ; elle retourne immanquablement à la boue, engluée dans un terrible processus d’autodestruction. Il aurait été facile de verser dans le psychologisme de bas étage, mais la réalisatrice n’interprète pas ce trop grand besoin d’amour. Au contraire, elle ne cesse de décentrer le propos : Suzanne est moins le récit d’un destin individuel que le portrait de ceux qui l’aiment, l’entourent...
La Jalousie, Philippe Garrel
écrit par Sullivan Caristan
Ils font du cinéma en famille. Dans La Jalousie, Louis Garrel, filmé par son père et secondé par sa sœur à l’écran, incarne un épisode inspiré de la vie de Maurice, son grand-père. Louis et Clotilde, parents de Charlotte, se séparent. La petite fille voit la scène par le trou de la serrure. Louis est maintenant avec Claudia avec qui il partage un amour ardent. Comédiens, ils sont tous deux fauchés. Des hommes et des femmes passent dans leur vie, non sans provoquer, surtout chez la jeune femme, des remous intérieurs, entre accès de jalousie et crises d’angoisse. Plus fragile et moins sûre de ses choix, Claudia voit un autre homme et finit par quitter Louis sur un coup de théâtre. Dommage, car Charlotte, qui compte beaucoup pour tout le monde, l’a acceptée dans sa vie et celle de son père. Fidèle à ce qu’il a annoncé un peu plus tôt (Si elle me quittait…le flingue), Louis tente de se suicider. Heureusement, Esther, sa sœur, très douce et sans jugement, est auprès de lui. L’amour, au cœur du film – les personnages se disent je t’aime et pourquoi ils s’aiment –, est représenté comme un équilibre précaire, à la merci du malentendu qui vient et qui s’immisce dans les sentiments. Si l’amour filial et l’amour fraternel, ici, résistent, le couple, lui, se disloque progressivement. Et à la fin, on souffre. Mais le film n’a rien à démontrer. Pas d’idée morale à illustrer et c’est ce qui le rend élégant et fort. Philippe Garrel nous donne juste à voir un peu de vie humaine. Bien sûr le film est bien plus qu’une succession d’instantanés, car il y a de la perspective, notamment à travers les deux personnages de mentors lettrés qui délivrent, en vieux soldats...