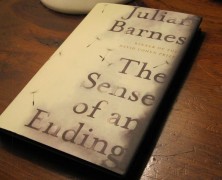Dans son dernier livre traduit en français, le grand romancier portugais poursuit sa recherche du temps perdu en convoquant tous les fantômes du passé au chevet d’un mourant. La magie de sa phrase opère et nous sommes plongés dans le labyrinthe de la mémoire. Une lecture déroutante et captivante. Il est des livres que l’on dévore, d’autres que l’on picore, d’autres enfin qui vous entraînent dans leur univers dès la première ligne. C’est le cas du roman d’Antonio Lobo Antunes, d’une lecture certes exigeante mais facilitée par sa brièveté inhabituelle et son découpage chronologique. L’histoire paraît simple, la narration structurée : opéré d’un cancer, un homme passe quinze jours à l’hôpital de Lisbonne, chaque jour étant évoqué en un chapitre daté. Quinze jours, quinze chapitres, quinze phrases. Et pourtant, rien n’est linéaire, ni la phrase, ni le récit. Dès la première ligne, nous nous échappons du huis clos et nous partons à la dérive : « De la fenêtre de l’hôpital à Lisbonne, ce n’était pas les gens qui entraient ni les voitures entre les arbres ni une ambulance qu’il voyait, c’était… Nous ne sommes plus au mois de mars à Lisbonne au chevet d’un homme malade, nous sommes aux sources du Mondego, dans la maison des étés, dans les odeurs de l’enfance, dans la récapitulation de toute une vie : « sa vie pleine de passés sans qu’il sache lequel d’entre eux était authentique, des réminiscences qui se superposaient, des souvenirs contradictoires, des images qu’il ne reconnaissait pas… » On pense à Apollinaire : « Mon beau navire ô ma mémoire/ Avons-nous assez navigué » et l’on est embarqués Au bord des fleuves qui vont. Dans l’entre-deux de la maladie et de l’anesthésie, les temps, les lieux et les personnages se répondent. Passé et présent se mêlent en un temps continu, selon cette conception d’un temps « élastique » que l’auteur dit avoir découvert en Afrique. L’identité devient floue et les voix multiples (parfois même au sein de la même phrase au risque de désarçonner le lecteur): voix de l’homme mûr et de celui qu’il fut enfant Antonio/Antoninho, du père et du grand-père, de l’infirmier et de Dona Irene…. comme autant de strates superposées et entrecroisées, voix des vivants et des disparus et même voix des choses. Plus encore que dans La mort de Carlos Gardel où l’auteur faisait se succéder au chevet d’un jeune drogué agonisant les voix de ses proches, celles-ci se superposent et s’entrechoquent ici et surgissent de la mémoire même du gisant. Le sujet s’estompe dans ce moment de la perte de soi : « Quelqu’un est mort à l’hôpital, lui ou un autre ». La première personne s’efface devant la troisième : « et moi au deuxième rang le huitième à partir de la droite, on le reconnaissait à son tablier » car, à la différence des chroniques, le roman, bien que nourri de l’expérience personnelle, s’échappe de l’autobiographique et touche à l’universel. Et si l’on s’égare parfois dans les méandres de la phrase et des souvenirs, on se laisse envoûter par cette prose sinueuse rythmée de leitmotive, par ces enchaînements de métaphores percutantes dont l’auteur a le secret : « l’oiseau de sa peur sans branche où poser tremblotantes les lèvres de ses ailes, la bogue d’un châtaignier auparavant à l’entrée du jardin et aujourd’hui au-dedans de lui que le médecin appelait cancer ». Dans ce long monologue intérieur les pensées, les sensations se succèdent avec la rapidité des associations d’idées dans un style elliptique qui se joue de la syntaxe et supprime les auxiliaires inutiles : « alors j’ai compris combien le Mondego une mélancolie laborieuse luttant pour s’exprimer, ils appellent ça un fleuve et sur ces rives nous cheminons avec l’espoir que ce soit en direction de la mer quand la mer inexistante, des pins, l’envie de faire connaissance de dona Lurdes » Par cette écriture du ressassement qui dit l’impossibilité de fixer le temps et le moi, le romancier fait encore une fois la preuve de la puissance de sa langue et...
La Femme au tableau, Simon Curtis
écrit par Célian Faure
A la mort de sa sœur, Maria Altmann, octogénaire charismatique et spirituelle établie à Los Angeles, se met en tête de récupérer cinq toiles de Gustav Klimt. Sa famille, des Juifs notables de la Vienne de l’entre-deux-guerres, en a été spoliée lors de l’annexion de l’Autriche par Hitler en 1938. Parmi ces trésors désormais possessions de l’Etat autrichien se trouve le célébrissime « Portrait d’Adèle », tante idôlatrée par Maria. Dans cette quête improbable, elle s’attache les services d’un jeune avocat américain, Randy Schönberg, petit-fils du musicien, qui va découvrir la nature profonde de l’humiliation subie par les Juifs à mesure qu’il explore ses propres origines. Il était à craindre que Simon Curtis s’abîme dans les poncifs du genre en livrant un énième mémorial des crimes nazis. Mais si le film respecte le cahier des charges du genre et frise par moment le déjà-vu, sa narration est efficace et son rythme impeccable. La mise en scène est sans fausse note et fourmille de bonnes idées. Helen Mirren, l’interprète de Maria, est sublime. Le mot est sans doute galvaudé, mais comment qualifier autrement ce charisme, cette force, cette dignité, cette drôlerie, cette charge émotionnelle évidente mais retenue, cette justesse, cette beauté ? La Femme au tableau se fonde sur le dialogue permanent entre deux époques. Au passé les faits et les souvenirs de Maria ; au présent le procès et les enjeux qui lui sont liés, pressions des gouvernements, de l’opinion publique, dédales administratifs et judiciaires. Dans cette perspective, le cinéaste se heurte à la difficulté de faire cohabiter les deux temporalités et recourt massivement aux flashbacks, dont il évite habilement les écueils : les nombreuses scènes du passé sont insérées avec pertinence et ne cèdent ni à un tragique stérile, ni à l’exotisme béta du film d’époque. Mieux que...
Les Femmes de Visegrad, Jasmila Zbanic
écrit par Célian Faure
A Visegrad, à l’est de l’actuelle Bosnie-Herzégovine, sur un territoire de la République serbe de Bosnie, la guerre fait rage en 1992. Ici, les Serbes sont en minorité face aux Bosniaques musulmans. Alors, quand la guerre éclate, on commence à massacrer. Sur le pont de Visegrad, rendu célèbre par le Prix Nobel de littérature Ivo Andric, le sang coule à flots. On égorge, on tue. Trois mille Bosniaques meurent sous la fureur serbe. Visegrad et sa région comptent alors près de vingt mille habitants. Kym Vercoe, une artiste australienne, passe à l’été 2011 ses vacances dans les Balkans. Désireuse de marcher sur les traces du Pont sur la Drina, le fameux roman d’Ivo Andric, elle se rend à Visegrad. Là, elle suit les conseils d’un guide touristique anglais et passe la nuit dans l’hôtel Vilina Vlas, un hôtel « romantique et plein de charme ». Mais, saisie d’une angoisse qu’elle n’explique pas, elle ne parvient pas à trouver le sommeil. De retour en Australie, elle découvre que l’établissement fut durant le nettoyage ethnique de 1992 un lieu de séquestration, de tortures, de viols et de meurtres pour deux cents femmes bosniaques. Bouleversée par l’absence de mémoire sur les lieux, terrifiée à l’idée d’y avoir passé la nuit en toute innocence, cette découverte l’obsède. Elle décide de revenir en Bosnie pour en apprendre davantage. Le film se concentre sur ce retour de Kym à Visegrad qui erre et filme tout. Il épouse alors la forme d’un documentaire terne, glacial, qui relate des faits parfois sans intérêt. La narration n’a rien de spectaculaire. Les Femmes de Visegrad se situe loin, très loin, du cinéma et du documentaire mémoriels qui parfois énervent par leur côté lénifiant et leur compassion guimauve. Ce genre ne joue souvent que sur...
Une Fille, qui danse, Julian Barnes
écrit par Guillaume Moreau
Comment continuer à vivre lorsque les vérités sur lesquelles on a fondé son existence s’effritent soudainement ? Telle est la grande question posée par le nouveau roman de Julian Barnes. Six ans après Arthur et George, l’écrivain anglais revient avec Une Fille qui danse, récit plutôt habile d’une enquête, d’un travail de “corroboration” du passé qu’entreprend le protagoniste à l’occasion d’un étrange legs… Anthony Webster est le narrateur de ce roman constitué de deux parties distinctes. Dans la première, il raconte les “souvenirs approximatifs” d’une frange de son adolescence lycéenne durant laquelle il fait la connaissance d’Adrian Fynn, un jeune homme mystérieux, plus brillant que lui et ses deux amis proches, Colin et Alex. Il y raconte aussi sa rencontre avec Veronica Ford, son premier amour, vaguement calculatrice et hautaine, du moins dans son souvenir. Suite à leur séparation, elle se met en couple avec Adrian, qui se suicide quelques temps après. La véritable habileté du récit tient à sa seconde partie, qui est une relecture, quelques cinquante ans plus tard, de cette adolescence : le jeune Tony est devenu Anthony Webster, marié-divorcé, père et grand-père, un vieil homme qui mène une retraite paisible, vaquant à l’entretien de sa maison et à ses activités bénévoles. Il hérite par la mère de Veronica Ford du journal intime de son ancien ami Adrian. Aiguillonné par le possible contenu de ce document, il décide de le récupérer auprès de Veronica, qui refuse de le lui remettre. A cette occasion, il va revisiter son passé, découvrir combien le temps a altéré ses souvenirs et à quel point il s’est aveuglé sur son histoire personnelle. Roman sur le passage du temps, sur les failles et les illusions de la mémoire, Une Fille qui danse bénéficie d’une construction romanesque ambitieuse...