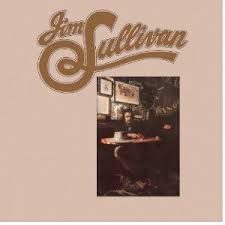Une Dernière Fois la nuit, Sébastien Berlendis
Vaincu par l’asthme, un homme s’éteint progressivement, recroquevillé dans le lit naufragé d’une maison à l’abandon. C’est la fin d’un long chemin. Il arrive d’Italie après avoir retrouvé les lieux qui ont constitué sa mythologie personnelle : la maison natale de Bracca, petite tache parmi les pins sombres, dont l’atmosphère étouffante favorise l’épanouissement de la maladie ; San Pellerino, lieu de la première cure, des premiers soins pour modérer les crises, et de la naissance de l’amour ; la villa Luigia au bord du lac de Côme, dans laquelle l’amour est porté à son comble, jusqu’à l’agonie, puis la mort ; Trieste, le réconfort apporté par la mer et le soleil, la joie des autres corps…et enfin la maison du dix, chemin de la Résistance, sur le plateau d’Assy, cette dernière nuit.
On devine que ces pérégrinations sont moins géographiques que mentales : l’homme se remémore, et le lecteur perçoit les traces de ces souvenirs au sein d’un jeu de reprises et de variations qui donne à l’ensemble l’allure d’un vaste poème en prose. La lecture est envoûtante, on se perd dans ce récit comme on se perdrait dans la contemplation d’un vieil album de famille. Dans sa forme discontinue, le récit se rapproche d’ailleurs de l’album : les blocs de texte sont les photos qu’on a délicatement collées sur l’espace blanc de la page. On les imagine en noir et blanc, parce que c’est ainsi que l’auteur souhaite nous raconter le parcours de cet homme dans cette Italie du Nord du début du siècle. Certains passages semblent envahis par un blanc solarisé, d’autres font la part belle au noir qui, dans sa dureté, crée d’émouvants effets de contraste. Ce jeu entre le noir et le blanc, tant sur la forme que sur le fond, exprime tout le paradoxe du récit.
En effet, sous bien des aspects, celui-ci se rapproche d’une plainte, d’une élégie sur laquelle plane la maladie, puissance funèbre contre laquelle on ne peut lutter : impossible d’échapper à l’asphyxie, à l’étouffement, malgré les soins, les dérivatifs, les divertissements. Pour autant, Une Dernière Fois la nuit n’est pas aussi sombre que son titre pourrait l’indiquer, et souvent, c’est le blanc qui domine. Sébastien Berlendis raconte ainsi l’éveil au corps, la sensualité frémissante des premiers instants. L’aspect morbide du récit de maladie est sans cesse allégé par l’aspect charnel de l’écriture. C’est à une ode à la sensualité que nous invite l’auteur : l’été est ainsi l’occasion de renouer avec ce corps honni, le soleil et la mer agissent comme de doux pansements sur la peau nue, ils calment les nerfs et permettent de respirer : « La lumière et les odeurs recommencées, le bruit du ressac. Je confonds facilement les étés, et devant cette mer, rien de ce que la vie arrache n’affleure sur mon visage ».
L’écriture se fait le miroir fidèle de cette sensualité. On entend parfois des accents de Duras dans ce rapport entre le plein et le vide, dans cette frontière ténue entre la fulgurance et le silence. Si la discontinuité du récit laisse toute sa place au blanc, celui-ci n’est que l’espace nécessaire à l’épanouissement de l’émotion. Bien souvent, les auteurs sombrent dans l’écueil d’une écriture trop dépouillée dont on ne retient finalement que le vide. Ici, rien de tout cela. On peut certes regretter l’usage un peu trop visible de la phrase nominale, mais on doit s’incliner devant la langue délicate, pudique et ciselée de ce premier récit.
Sébastien Berlendis, Une Dernière Fois la nuit, Stock, 2013, 96 pages
Photo: Sébastien Berlendis.